« La Vida loca » : tuer pour vivre, vivre pour tuer…

Christian Poveda, sortie 30 septembre 2009
jeudi 3 septembre 2009 : on vient d’apprendre l’assassinat de Christian Poveda, le réalisateur de ce film, il a été tué par balles cette nuit au Salvador au retour d’un tournage dans la campanera d’une banlieue contrôlée par les gangs, comme celle où il a tourné « La Vida Loca », macabre épilogue à ce film qui n’avait nul besoin de cette triste pub pour être un choc pour le spectateur, hommage son courage, une qualité qui se fait rare…
Dans les banlieues de Salvador, deux gangs de « Maras » terrorisent le pays : la « clica » MS (Mara Salvatrucha) et la « clica » 18 ; pour des raisons pratiques, Christian Poveda, réalisateur issu du photojournalisme, a choisi de suivre le quotidien de la clica 18 pendant un an et demi et en a tiré un documentaire dont le moins qu’on puisse dire est qu’il est choc.Suivre un gang, c’est obtenir au préalable l’autorisation des chefs du gang et celle de la police. Suivre un gang, c’est être confronté à la mort de certains d’entre eux, acteurs du film… Car la vie à la Campanera, sorte de grande favella plate dans la banlieue de Salvador, est rythmée par la mort, les enterrements, les descentes de polices, on n’en sort vivant que pour la prison ou la maison de correction. Naturellement, le réalisateur se focalise sur un certains nombres de personnages dont il suit de près l’évolution parfois stoppée par leur mort brutale, tirés comme des lapins par la police ou le gang ennemi.
—–

photo CinéClassic distribution
Le film démarre par un enterrement, un récit rythmé ponctuellement par des coups de feu, un autre enterrement, la veuve se lamente, les amis crient justice, les morts connaissent alors le premier et le dernier luxe de leur vie, de leur mort, un beau cercueil blanc transparent tapissé de satin blanc avec des fleurs rouges et roses. Dans la vie, ils n’avaient rien sauf des tatouages parfois sur tout le corps, la tête, le visage, des marques d’appartenance au gang, hybride entre l’armée et la famille ; à Salvador, appartenir à un gang est une sorte de filiation, du moins une fraternité entre parias, des ados, des jeunes mères de moins de 20 ans, tous liés par les carences en tout, la famille absente ou démissionnaire, vivant dans une extrême précarité dans tous les cas.On cherche en vain les pères de la plupart des enfants, les questionnaires à l’hôpital sont accablants, aux questions à cette femme de 27 ans, mère de quatre enfants, qu’on va enfin opérer, elle répond aucun moyen de subsistance, pas de père au foyer, la routine… C’est d’ailleurs l’histoire la plus poignante, si tant est qu’il soit possible d’établir une hiérarchie dans l’échelle des souffrances. La mère du jeune homme non tatoué (c’est bien le seul) convoqué par le juge ne se donne aucun mal pour que son fils ne soit pas envoyé en maison de correction, encore moins pour l’en sortir, totalement passive, bizarrement, c’est le fils, dans un premier temps, qui pousse presque sa mère à le faire enfermer, au moins il restera vivant et ira à l’école… La mère adoptive d’une très jeune femme de 19 ans (La Chucky, du film d’horreur éponyme, soit la poupée qui tue), qui vient de se faire stériliser après l’accouchement d’un second enfant, lui confie qu’elle lui a été donnée par sa mère biologique à 6 jours, même pas lavée… Adulte, La Chucky retrouvant enfin cette mère qui n’a pas voulu d’elle, une femme absente, indifférente, n’ayant pas moins de 11 enfants à élever, cette dernière lui ment sans conviction, parle d’un prêt et non d’un don, elle aurait prêté sa fille bébé pour tenir compagnie à une amie malade qui ne la lui aurait pas rendue à cause de l’argent dépensé, investi…

photo CinéClassic distribution
Seul espoir dans ce cauchemar, des ONG de réinsertion avec la boulangerie coopérative menée par un ex-« pandillero » des gangs repenti. L’équipe de bras cassés tente de renaître dans ce premier emploi miraculeux, entravés chaque jour par les arrestations de la police militaire, les fouilles des milices, tout tatoué étant d’abord considéré comme un suspect, un des maras dont il faut nettoyer la ville, programme du gouvernement. Hors de sa rue, la jeune fille de 19 ans (La Liro), un enfant avec El Bamban, le tatoueur officiel du gang, portant le 18 tatoué sur tout le visage depuis l’âge de 17 ans (peut-être de force?), se ferait certainement abattre, soit par la police, soit par le gang rival. Il y a des scènes terribles de groupes à genoux, torse nus, les mains dans le dos menottées, ou contre un mur la nuit, les miliciens portant des cagoules noires. Second espoir pour certains, la religion, le pasteur qui répète toujours la même rengaine lors des enterrements, sorti de maison de correction, le jeune homme non tatoué se fera baptiser par tactique.
Un seul objectif pour ces exclus de l’humanité, puisqu’ils n’espèrent plus le droit d’exister : la mort, jouer avec la mort, la devancer, s’entretuer avec la clica MS rivale, quel futur sinon la mort, le jeu macabre étant de savoir quel jour… on note le vocabulaire guerrier… « canarder », « buter », un « gun », etc… Fratricide guerre sans fin entre ces gangs d’ados (moyenne d’âge 16/18 ans), structurés comme des armées clandestines, vivant en autarcie dans leur Campanera avec une hiérarchie, des règles, des chefs ; la violence ne se retournant plus seulement contre l »oppresseur, contre cette société qui les a rejetés depuis la naissance, mais contre l’opprimé de la bande adverse, on s’entretue aussi entre exclus, les pauvres contre les riches, puis les pauvres contre les pauvres de la clica rivale, jusqu’à ce qu’il ne reste plus personne?

photo CinéClassic distribution
Très beau film très dur, même pour les plus aguerris, où l’on assiste à un spectacle sidérant pour nos sociétés de pléthore : ces gamins, souvent eux-mêmes parents, n’ayant de place nulle part sur cette terre, font preuve d’intrépidité, d’endurance et de dignité, même dans la violence extrême, cette dignité même de citoyen qui leur est refusée. Documentaire filmé comme une fiction, le réalisateur n’est pas dans l’urgence, en immersion dans la Clica 18 pendant plus d’un an, en empathie avec les protagonistes, d’où la qualité des images et des plans, on sent qu’il a fait des choix au profit d’un fil narratif rigoureux ; au montage, il insufflera du rythme, des accélérations, une belle BO musicale ciblée, le leit-motiv des coups de feu off comme des arrêts sur image/récit, une sobriété travaillée, préméditée, mais de mise tant le sujet est fort, la conscience que nul artifice n’aurait autant de force que la réalité. D’ailleurs, le spectateur occidental, cloué sur son confortable fauteuil de cinéma (oubliant le temps d’une projection la récession, la pandémie de grippe A, le risque d’explosion de son Iphone…) par le récit de ces tueries ritualisées, quasiment suicidaires, entre les deux gangs, perd de temps en temps de vue qu’il s’agit d’un documentaire. Sur le tatouage d’un pandillero, la devise d’un des membres du gang « Mata para vivir, vive para matar » (« Tue pour vivre, vis pour tuer ») rappelle, qu’au delà de la dimension ludique du combat de ces gladiateurs adolescents, il ne s’agit pas d’une fiction ciné.
Notre note
 (3 / 5)
(3 / 5)


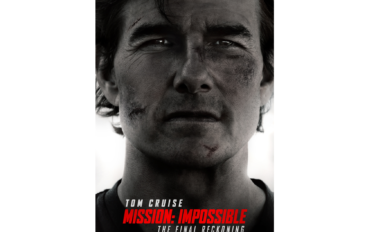



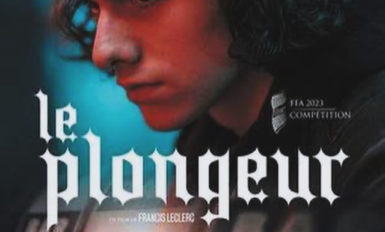

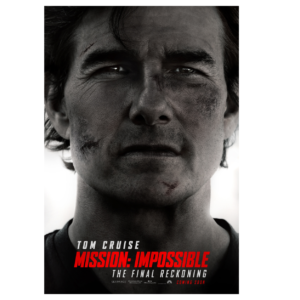






Laisser un commentaire