"Nightmare alley" ("Le Charlatan") : le grand blasphème

Un intérêt non négligeable de manquer de culture, c’est qu’on passe son temps à découvrir des choses étonnantes. Qui, en dehors de quelques connaisseurs de la mémoire du cinéma, se serait douté que derrière un titre aussi bateau que «Le charlatan», «Nightmare Alley» pour les puristes, se cachait une pépite enfouie depuis 1947 ? Et pourtant On veille un peu après Soir 3, en attendant négligemment le Ciné Club de France 3, vaguement attiré par un générique mentionnant Tyrone Power. Ca fait quelques temps qu’on n’a rien vu avec cette gloire passée de Hollywood, après tout. Le réalisateur, Edmund Goulding, quelqu’un connaît ? Pourtant, «Une nuit à l’Opéra» avec les Marx Brothers, «La Patrouille de l’Aube» avec Errol Flynn, «Grand Hotel» avec Greta Garbo et Oscar 1932 du meilleur film, tout ça c’est lui. Pas n’importe qui quand même ! Et puis le film commence, sur un de ces génériques d’époque, avec cartons de présentation enluminés. La nostalgie remonte, un brin taquine, juste histoire d’éveiller l’attention. Enfin, le film commence, et ce qui n’était qu’une vague vigilance du coin de l’il devient en quelques minutes une glue puissante qui rive le regard à l’écran et le corps au fond du fauteuil
—–
L’histoire débute dans un stand de foire, au milieu des cracheurs de feu et autre montreur de monstre. Zeena (Joan Blondell) et Pete (Ian Keith) ont un numéro de divination. Stanton Carlisle (Tyrone Power) les seconde depuis que Pete a sombré dans l’alcool, restant soutenu à bout de bras par Zeena. A force d’insistance, et surtout après l’accident mortel de Pete dont il se sent indirectement responsable, Stanton réussit à soutirer de Zeena le code qui sert de truc pour leur numéro. Voyant alors l’opportunité de développer le tour en quittant la modeste foire itinérante pour les cabarets de Broadway, Stanton séduit Molly (Coleen Gray), sur le stand voisin, puis prend son envol. Le succès est rapide sous les feux de la rampe. Rapidement, Stanton se fait prendre dans les filets de Lilith Ritter (Helen Walker), une psychologue de la bonne société qui, d’abord intriguée par le décryptage du fameux code, lui propose de lui livrer les secrets confiés par ses clients pour les utiliser à des fins lucratives lors des numéros de Stanton. Ils piègent ainsi un fortuné naïf qui désire ardemment communiquer avec feue l’amour de sa vie. Mais l’arnaque nécessite la complicité de Molly qui, après s’être résolue à contre cur à entrer dans la combine, est prise de remords et flanche au milieu de la duperie, révélant ainsi le piège au riche pigeon Ezra Grindle (Taylor Holmes). Tentant de limiter les dégâts, Stanton tente de rejoindre Lilith, pour alors se rendre compte qu’elle jouait pour son propre compte et qu’elle a lancé la police à ses trousses. Commence alors pour Stanton une cavale le menant de Charybde en Scylla jusqu’au fond de la misère et de l’alcoolisme.
Film étrange et étonnant à plus d’un titre. Dans la carrière d’un Tyrone Power tombé à l’époque dans une certaine désaffection, et en un temps où il n’était pas monnaie courante de briser son image, le héros de ces dames à la plastique parfaite n’hésite pas à laisser au fil du film son physique péricliter au point d’en finir quasi méconnaissable. L’histoire elle-même de la descente aux enfers de l’alcool, sans autre retour que le mélange d’amour et de pitié de Molly pour l’épave monstrueuse qu’il devient, fait de Stanton un personnage inattendu. Au plan narratif, le film est construit comme une boucle, probablement la énième d’une spirale sans fin, où la situation finale est la copie conforme de celle présente à l’introduction du film, les personnages initialement secondaires ayant simplement remplacé les personnages principaux. Sur le fond, un des arguments du film est la confrontation de Stanton avec Lilith dans une manipulation psychologique à tiroir : l’exploration des limites, des perversions, des dérives de la psychothérapie professionnelle est probablement une des premières occasions pour Hollywood de se pencher sur le sujet de cette façon. Autre thème : l’exploitation de la religiosité à des fins de spectacle puis d’escroquerie en un temps et dans un pays où le sentiment religieux fait justement partie intégrante de la citoyenneté.
On comprend aisément comment ce film inclassable eut du mal à trouver son public. Initialement un échec commercial, peu servi par une promotion discrète de la part d’un producteur sur la défensive et hâtivement rangé au rayon des séries B destinées à un oubli rapide, puis introuvable pendant une longue période du fait d’une obscure querelle de droits d’auteurs, le film n’a repris vie que quelques dizaines d’années plus tard pour atteindre à un statut de véritable film culte dans un cercle d’initiés.

Pourtant, le film ne manque pas des qualités qui lui auraient mérité un plus large succès. A commencer par une interprétation largement empreinte de nuances et de finesse à des kilomètres d’un monolithisme de caricature. Chaque personnage, et Stanton au premier chef, évolue lentement tout au long de l’histoire. Les sentiments sont contrastés, mouvants, précaires. Les actions sont crédibles, à peine exagérées si ce n’est pour en souligner les traits essentiels. Le sentiment de culpabilité de Stanton devant la mort de Pete est ainsi tout simplement humain, simplement là pour briser l’image monstrueuse qui se tissait, sans autre valeur explicative sur son comportement à venir que celle de définir un homme réel, certes ambitieux, mais sans autre perversité profonde. Son mariage avec Molly est presque forcé, réparant presque sans hésitation la faute qu’il semble avoir commise. Bien sûr, la lourde machine de l’ambition se met rapidement en uvre et Stanton entrevoit en quelques instants le bénéfice qu’il pourra tirer de la situation, mais l’impulsion initiale était bien loin d’une quelconque turpitude.
Ainsi entraîné sur le chemin de la gloire et d’un destin de « Great Stanton », les compromissions, les tentations, les facilités de Carlisle s’accumulent ensuite en strates de plus en plus lourdes jusqu’à l’inévitable chute dans une spirale inverse. Jusqu’à jouer avec la faiblesse humaine et plus seulement sur le caractère ludique de la démonstration de music-hall, jusqu’au blasphème de se présenter comme un démiurge dont on sait depuis Moïse, interdit de Terre Promise pour avoir fait jaillir une source d’un coup de son bâton sur un rocher sans en avoir crédité Dieu, à quel point cela ne peut rester impuni. La scène de l’apparition nocturne de l’amour perdu d’Ezra Grindle au travers d’une fontaine au centre d’une allée bordée d’arbres à l’image des rangées colonnes de part et d’autre de la nef d’une immense cathédrale est ainsi un monument de symbolisme à la fois lourd de sens, lourd de l’ambiance de mystique confiance qui s’est progressivement crée, lourd de cet état de rêverie propre aux attentes les plus profondes. Qualité de la rêverie, mais aussi de la rupture, de la défaillance de Molly, de la révélation de la supercherie. Qualité d’une mise en scène parfois chargée, mais au seul profit du sens de l’action, et renvoyant la violence des sentiments de Stanton et de Grindle dans la sobriété des regards.
Comment un tel film, pour de basses raisons d’image – image de la star, image de la religion, image du héros -, a pu être à ce point négligé par son producteur et relégué au fin fond des rogatons de la pellicule est finalement peut-être le plus grand blasphème qu’il ait pu susciter.
Notre note
 (4 / 5)
(4 / 5)










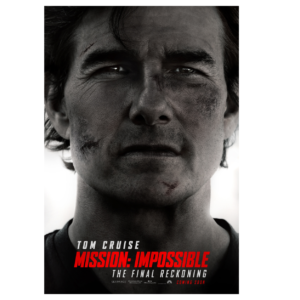




Laisser un commentaire